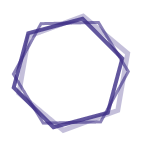RESUMO
OBJECTIVES: The biomechanics of the healthcare professionals (HCPs) performing the life-saving intervention of chest compressions in the neonatal population is poorly understood. The aim of this pilot study was to describe the variations in body position at a self-selected and a predetermined bed height during neonatal chest compressions. Measures of joint angles, time to postural sway and number of postural adjustments were chosen as indices for the stability of the HCP's position. SETTING: Data were collected at a simulation-based research centre in which the patient care environment was replicated. PARTICIPANTS: HCPs with varying roles working in the neonatal intensive care unit and holding a current Neonatal Resuscitation Program Provider certification were recruited for this study. INTERVENTIONS: Fifteen HCPs performed two trials of chest compressions, each lasting 2 min, at a predetermined bed height and a self-selected bed height. Trials were video recorded, capturing upper and lower body movements. Videos were analysed for time to postural sway and number of postural adjustments. Joint angles were measured at the start and end of each trial. RESULTS: A statistically significant difference was found between the two bed height conditions for number of postural adjustments (p=0.02). While not statistically significant, time postural sway was increased in the choice bed height condition (85 s) compared with the predetermined bed height (45 s). After 30 s of chest compressions, mean shoulder and knee angles were smaller for choice bed height (p=0.03, 95% CI Lower=-12.14, Upper=-0.68 and p=0.05, 95% CI Lower=3.43, Upper=0.01, respectively). After 1 min and 45 s of chest compressions, mean wrist angles were smaller in the choice bed height condition (p=0.01, 95% CI Lower=-9.20, Upper=-1.22), stride length decreased between the 30 s and 1 min 45 s marks of the chest compressions in the predetermined height condition (p=0.02).
Assuntos
Reanimação Cardiopulmonar , Manequins , Fenômenos Biomecânicos , Atenção à Saúde , Humanos , Recém-Nascido , Projetos PilotoRESUMO
INTRODUCTION: the objective of this study was to evaluate the incidence of Chronic Intervillositis of Unknown Etiology (CIUE) at our institution and to report on the pregnancy outcomes based on severity of lesions. METHODS: retrospective cohort study including 29 889 perinatal specimens from 27 968 patients. The pathology database at our institution was queried for the keywords "intervillositis" and "CIUE" between February 2006 and April 2019. Histology was re-examined using a standardized diagnostic criterion to confirm diagnosis. Cases in which diagnosis was confirmed were categorized as low grade (5-49% intervillous space involvement) or high grade (≥50% involvement). Interventions and pregnancy outcomes were recorded. RESULTS: The overall prevalence of CIUE is 0.17% (47 of 27 968 patients), with significantly higher prevalence in 1st trimester products of conception compared with 2nd and 3rd trimester specimens (0.38% vs 0.09%; p < 0.0001). A total of 97 specimens were initially diagnosed with chronic intervillositis. 56 out of 97 (57.7%) specimens met our diagnostic criteria for CIUE on review. Pregnancies with confirmed CIUE had significantly higher rates of pregnancy loss compared with pregnancies with chronic intervillositis not meeting our study criteria for CIUE (94% vs 71%; p = 0.003). Pregnancy loss between low grade (42.9%; 24 out of 56 cases of CIUE) and high grade (57.1%; 32 out of 56 cases) CIUE were not significantly different. DISCUSSION: CIUE prevalence is low at 0.17%, but it is associated with pregnancy loss, particularly in the first trimester. High grade disease may be associated with worse pregnancy outcomes than low grade disease.
Assuntos
Aborto Espontâneo/imunologia , Doenças Placentárias/epidemiologia , Adulto , Colúmbia Britânica/epidemiologia , Feminino , Humanos , Doenças Placentárias/imunologia , Gravidez , Resultado da Gravidez/epidemiologia , Prevalência , Recidiva , Estudos RetrospectivosRESUMO
OBJECTIVE: The shift to competency-based medical education (CBME) is associated with changes in the way residents are taught and assessed. Although there are many purported benefits of CBME, an understanding of the preparedness of faculty to meet the needs of this new paradigm is lacking. The aim of this study was to characterize faculty needs to support the transition to CBME. METHODS: An online survey was designed with the aim of characterizing faculty understanding of the principles of CBME and common trainee assessment methods, as well as exploring barriers to the implementation of CBME in obstetrics and gynaecology residency programs across Canada. The survey was sent to faculty across Canada in English and French. RESULTS: A total of 284 responses were collected between September 2015 and December 2016. Although most faculty viewed CBME as a positive change, there were gaps in their knowledge about CBME and workplace-based assessment methods. Barriers to the implementation of CBME included lack of training in assessment of residents and feedback, financial implications, and time constraints. CONCLUSION: To facilitate the transition to CBME, institutions may need to consider establishing faculty training programs and implementing systemic change aimed at addressing faculty needs and barriers during this fundamental shift in the structure of residency training.
Assuntos
Educação Baseada em Competências , Docentes de Medicina/psicologia , Ginecologia/educação , Internato e Residência , Obstetrícia/educação , Canadá , Feminino , Humanos , Percepção , GravidezRESUMO
The development of a Canadian competency-based medical education (CBME) curriculum in obstetrics and gynaecology, slated to begin in 2017, must be rooted in, and aligned with, the principles of CanMEDS 2015 and Competence by Design. It must also reflect the unique realities of the practice of the specialty. The Dutch Society of Obstetrics and Gynaecology has been at the forefront of the movement to design and implement competency-based training for obstetrics and gynaecology. The Dutch curriculum represents a practical example of how such a program could be developed. Several CBME curricular initiatives have now also begun across Canada.
La mise sur pied d'un curriculum canadien de formation médicale fondée sur les compétences (FMFC) en obstétrique-gynécologie (devant débuter en 2017) doit être ancrée dans les principes des programmes « CanMEDS 2015 ¼ et « La compétence par conception ¼. Ce curriculum doit également refléter les réalités particulières de la pratique de la spécialité. La Dutch Society of Obstetrics and Gynaecology est à l'avant-garde du mouvement visant la conception et la mise en Åuvre de la formation fondée sur les compétences en obstétrique-gynécologie. Le curriculum hollandais représente un exemple pratique de la façon dont un tel programme pourrait être élaboré. Plusieurs initiatives de FMFC ont maintenant vu le jour au Canada.
Assuntos
Educação Baseada em Competências/métodos , Educação Médica/métodos , Ginecologia/educação , Obstetrícia/educação , Humanos , Sociedades MédicasRESUMO
OBJECTIVE: To become culturally competent practitioners with the ability to care and advocate for vulnerable populations, residents must be educated in global health priorities. In the field of obstetrics and gynaecology, there is minimal information about global women's health (GWH) education and interest within residency programs. We wished to determine within obstetrics and gynaecology residency programs across Canada: (1) current GWH teaching and support, (2) the importance of GWH to residents and program directors, and (3) the level of interest in a national postgraduate GWH curriculum. METHODS: We conducted an online survey across Canada of obstetrics and gynaecology residency program directors and senior obstetrics and gynaecology residents. RESULTS: Of 297 residents, 101 (34.0%) responded to the survey and 76 (26%) completed the full survey. Eleven of 16 program directors (68.8%) responded and 10/16 (62.5%) provided complete responses. Four of 11 programs (36.4%) had a GWH curriculum, 2/11 (18.2%) had a GWH budget, and 4/11 (36.4%) had a GWH chairperson. Nine of 10 program directors (90%) and 68/79 residents (86.1%) felt that an understanding of GWH issues is important for all Canadian obstetrics and gynaecology trainees. Only 1/10 program directors (10%) and 11/79 residents (13.9%) felt that their program offered sufficient education in these issues. Of residents in programs with a GWH curriculum, 12/19 (63.2%) felt that residents in their program who did not undertake an international elective would still learn about GWH, versus only 9/50 residents (18.0%) in programs without a curriculum (P < 0.001). CONCLUSION: Obstetrics and gynaecology residents and program directors feel that GWH education is important for all trainees and is currently insufficient. There is a high level of interest in a national postgraduate GWH educational module.
Objective: Pour devenir des praticiens compétents sur le plan culturel étant en mesure de prodiguer des soins aux populations vulnérables et de défendre leur cause, les résidents doivent recevoir une formation abordant les priorités de la santé à l'échelle mondiale. Dans le domaine de l'obstétrique-gynécologie, nous ne disposons que de peu de renseignements au sujet de la formation en santé des femmes à l'échelle mondiale (SFEM) qu'offrent les programmes de résidence et de l'intérêt envers ce type de formation que l'on y constate. Nous souhaitions déterminer ce qui suit en ce qui concerne les programmes canadiens de résidence en obstétrique-gynécologie : (1) la situation actuelle pour ce qui est de l'enseignement de la SFEM et du soutien disponible à cet égard; (2) l'importance de la SFEM pour les résidents et les directeurs de programme; et (3) le degré d'intérêt envers un curriculum national de cycle supérieur dans le domaine de la SFEM. Méthodes : Nous avons mené, à l'échelle du Canada, un sondage en ligne auprès des directeurs des programmes de résidence en obstétrique-gynécologie et des résidents de dernière année du domaine. Résultats : Parmi les 297 résidents sollicités, 101 (34,0 %) ont répondu au sondage et 76 (26 %) ont rempli le sondage en entier. Onze des 16 directeurs de programme sollicités (68,8 %) ont répondu et 10/16 (62,5 %) nous ont fourni des réponses complètes. Quatre des 11 programmes (36,4 %) comptaient un curriculum de SFEM, 2/11 (18,2 %) comptaient un budget de SFEM et 4/11 (36,4 %) comptaient un président de la SFEM. Neuf directeurs de programme sur 10 (90 %) et 68 résidents sur 79 (86,1 %) étaient d'avis qu'une compréhension des questions de SFEM est importante pour tous les stagiaires canadiens en obstétrique-gynécologie. Seulement un directeur de programme sur 10 (10 %) et 11 résidents sur 79 (13,9 %) étaient d'avis que leur programme offrait une formation suffisante sur ces questions. Parmi les résidents des programmes comptant un curriculum de SFEM, 12/19 (63,2 %) étaient d'avis que les résidents de leur programme qui n'entreprenaient pas un stage au choix international auraient tout de même l'occasion de se sensibiliser à la SFEM, par comparaison avec seulement neuf des 50 résidents (18,0 %) des programmes ne comptant pas un tel curriculum (P < 0,001). Conclusion : Les résidents et les directeurs de programme du domaine de l'obstétrique-gynécologie estiment que la formation au sujet de la SFEM est importante pour tous les stagiaires et qu'elle est actuellement insuffisante. La mise sur pied d'un module pédagogique national de cycle supérieur en SFEM suscite un vif intérêt.
Assuntos
Ginecologia/educação , Internato e Residência , Obstetrícia/educação , Saúde da Mulher , Canadá , Currículo , Feminino , Humanos , Inquéritos e QuestionáriosRESUMO
OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine the influence of planned mode and planned timing of delivery on neonatal outcomes in infants with gastroschisis. STUDY DESIGN: Data from the Canadian Pediatric Surgery Network cohort were used to identify 519 fetuses with isolated gastroschisis who were delivered at all tertiary-level perinatal centers in Canada from 2005-2013 (n = 16). Neonatal outcomes (including length of stay, duration of total parenteral nutrition, and a composite of perinatal death or prolonged exclusive total parenteral nutrition) were compared according to the 32-week gestation planned mode and timing of delivery with the use of the multivariable quantile and logistic regression. RESULTS: Planned induction of labor was not associated with decreased length of stay (adjusted median difference, -2.6 days; 95% confidence interval [CI], -9.9 to 4.8), total parenteral nutrition duration (adjusted median difference, -0.2 days; 95% CI, -6.4 to 6.0), or risk of the composite adverse outcome (relative risk, 1.7; 95% CI, 0.1-3.2) compared with planned vaginal delivery after spontaneous onset of labor. Planned delivery at 36-37 weeks' gestation was not associated with decreased length of stay (adjusted median difference, 5.9 days; 95% CI, -5.7 to 17.5), total parenteral nutrition duration (adjusted median difference, 3.2 days; 95% CI, -7.9 to 14.3), or risk of composite outcome (relative risk, 2.3; 95% CI, 0.8-5.4) compared with planned delivery at ≥38 weeks' gestation. CONCLUSION: Infants with gastroschisis who were delivered after planned induction or planned delivery at 36-37 weeks' gestation did not have significantly better neonatal outcomes than planned vaginal delivery after spontaneous onset of labor and planned delivery at ≥38 weeks' gestation.
Assuntos
Parto Obstétrico/métodos , Gastrosquise , Idade Gestacional , Tempo de Internação/estatística & dados numéricos , Nutrição Parenteral/estatística & dados numéricos , Sistema de Registros , Adulto , Canadá , Cesárea/métodos , Estudos de Coortes , Feminino , Humanos , Recém-Nascido , Trabalho de Parto Induzido/métodos , Modelos Logísticos , Masculino , Análise Multivariada , Avaliação de Resultados em Cuidados de Saúde , Gravidez , Estudos Prospectivos , Centros de Atenção Terciária , Fatores de Tempo , Adulto JovemRESUMO
Competency-based medical education (CBME) is a new educational paradigm that will enable the medical education community to meet societal, patient, and learner needs of the 21st century. CBME offers a renewed commitment to both clinical and educational outcomes, a new focus on assessment and developmental milestones, a mechanism to promote a true continuum of medical education, and a method to promote learner-centred curricula in the context of accountability. Accountability is central to CBME, ensuring that graduating practitioners are well-rounded and competent to provide safe and effective patient care. The structure of CBME in obstetrics and gynaecology must be rooted in, and reflect, Canadian practice. Its development and implementation require an understanding of the principles that are the foundation of CBME, along with the involvement of the entire community of obstetricians and gynaecologists and other maternity care providers. We provide here an overview of the basic principles of teaching and learning and the theories underpinning CBME.
La formation médicale axée sur les compétences (FMAC) est un nouveau paradigme pédagogique qui permettra à la communauté de la formation médicale de répondre aux besoins de la société, des patients et des apprenants du 21e siècle. La FMAC offre un engagement renouvelé envers les issues tant cliniques que pédagogiques, un nouvel accent sur l'évaluation et les jalons du développement, un mécanisme visant à promouvoir un réel continuum de formation médicale, ainsi qu'une méthode permettant de promouvoir un curriculum axé sur l'apprenant dans le contexte de la responsabilité. La responsabilité est au cÅur de la FMAC, ce qui permet d'assurer l'obtention de diplômés épanouis et compétents qui seront en mesure d'offrir des soins sûrs et efficaces aux patients. Dans le domaine de l'obstétrique-gynécologie, la structure de la FMAC doit être fondée sur la pratique canadienne et la refléter. Son élaboration et sa mise en Åuvre nécessitent une compréhension des principes qui étayent la FMAC, en plus de solliciter la participation de l'ensemble de la communauté des obstétriciens-gynécologues et celle d'autres fournisseurs de soins de maternité. Nous offrons ici un aperçu des principes de base de l'enseignement et de l'apprentissage, et des théories qui sous-tendent la FMAC.
Assuntos
Educação Baseada em Competências , Educação Médica , Ginecologia/educação , Obstetrícia/educação , Canadá , Educação Baseada em Competências/métodos , Educação Baseada em Competências/tendências , Educação Médica/organização & administração , Educação Médica/tendências , Avaliação Educacional/métodos , Humanos , Avaliação das Necessidades , Ensino/métodos , Ensino/tendênciasRESUMO
OBJECTIVE: To present an approach, based on current evidence, for the diagnosis, treatment, and thromboprophylaxis of venous thromboembolism in pregnancy and postpartum. EVIDENCE: Published literature was retrieved through searches of PubMed, Medline, CINAHL, and The Cochrane Library from November 2011 to July 2013 using appropriate controlled vocabulary (e.g. pregnancy, venous thromboembolism, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, pulmonary thrombosis) and key words (e.g., maternal morbidity, pregnancy complications, thromboprophylaxis, antithrombotic therapy). Results were restricted to systematic reviews, randomized control trials/controlled clinical trials, and observational studies published in English or French. There were no date restrictions. Grey (unpublished) literature was identified through searching the websites of clinical practice guideline collections, clinical trial registries, and national and international medical specialty societies. VALUES: The quality of evidence in this document was rated using the criteria described in the Report of the Canadian Task Force on Preventative Health Care (Table 1).
Objectif : Présenter une approche, fondée sur les données actuelles, envers le diagnostic, la prise en charge et la thromboprophylaxie de la thromboembolie veineuse pendant la grossesse et la période postpartum. Résultats : La littérature publiée a été récupérée par l'intermédiaire de recherches menées dans PubMed, Medline, CINAHL et The Cochrane Library entre novembre 2011 et juillet 2013 au moyen d'un vocabulaire contrôlé (p. ex. « pregnancy ¼, « venous thromboembolism ¼, « deep vein thrombosis ¼, « pulmonary embolism ¼, « pulmonary thrombosis ¼) et de mots clés (p. ex. « maternal morbidity ¼, « pregnancy complications ¼, « thromboprophylaxis ¼, « antithrombotic therapy ¼) appropriés. Les résultats ont été restreints aux analyses systématiques, aux essais comparatifs randomisés / essais cliniques comparatifs et aux études observationnelles publiés en anglais ou en français. Aucune restriction n'a été imposée en matière de dates. La littérature grise (non publiée) a été identifiée par l'intermédiaire de recherches menées dans les sites Web d'organismes s'intéressant à l'évaluation des technologies dans le domaine de la santé et d'organismes connexes, dans des collections de directives cliniques, dans des registres d'essais cliniques et auprès de sociétés de spécialité médicale nationales et internationales. Valeurs : La qualité des résultats est évaluée au moyen des critères décrits dans le rapport du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (Tableau). Recommandations 1. La tenue d'un examen objectif s'avère requise lorsque la présence d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie pulmonaire est soupçonnée sur le plan clinique. (II-2A) 2. Pour diagnostiquer la présence d'une thrombose veineuse profonde, il est recommandé d'avoir recours à une échographie; lorsque l'examen initial donne des résultats négatifs, il est recommandé de mener une nouvelle échographie à au moins une reprise au cours des sept jours suivants. Dans le cadre de chacun des examens, l'intégralité du système veineux (de la veine iliaque externe à la veine poplitée) doit être visualisée et des manÅuvres de compression doivent être appliquées de la veine fémorale à la veine poplitée. (II-2B) 3. Pour diagnostiquer la présence d'une embolie pulmonaire, tant la scintigraphie de ventilation-perfusion que l'angiographie par tomodensitométrie peuvent être utilisées. (II-2A) Chez les femmes enceintes, la scintigraphie de ventilation-perfusion constitue le test à privilégier. (III-B) 4. Ni la seule détermination du taux de D-dimères ni l'application de règles de prédiction cliniques ne devraient être utilisées pour écarter la présence possible d'une thromboembolie veineuse chez les femmes enceintes sans avoir recours à un examen objectif. (III-D) 5. Les femmes enceintes ayant obtenu un diagnostic de thromboembolie veineuse aiguë devraient être hospitalisées ou encore faire l'objet d'un suivi étroit en clinique externe au cours des deux premières semaines suivant l'établissement du diagnostic initial. (III-C) 6. L'héparine de bas poids moléculaire est l'agent pharmacologique à privilégier, par rapport à l'héparine non fractionnée, pour la prise en charge de la thromboembolie veineuse pendant la grossesse. (II-2A) 7. Il est extrêmement rare de constater une thrombocytopénie induite par l'héparine chez les femmes enceintes. La consultation d'un hématologue ou d'un spécialiste de la thrombose est recommandée au moment d'envisager l'utilisation d'héparanoïdes pour la prise en charge d'une thromboembolie veineuse, le cas échéant. (II-3B) 8. L'utilisation d'antagonistes de la vitamine K pour la prise en charge de la thromboembolie veineuse pendant la grossesse ne devrait être envisagée que dans des circonstances exceptionnelles. (II-2A) 9. Nous nous prononçons contre l'utilisation des inhibiteurs du facteur Xa et des inhibiteurs directs de la thrombine administrés par voie orale pour la prise en charge de la thromboembolie veineuse pendant la grossesse. (III-D) 10. Pour la prise en charge de la thromboembolie veineuse aiguë pendant la grossesse, nous recommandons le respect de la posologie recommandée par le fabricant pour chacune des héparines de bas poids moléculaire, en fonction du poids actuel de la patiente. (II-1A) L'héparine de bas poids moléculaire peut être administrée une ou deux fois par jour, selon l'agent sélectionné. (III-C) 11. Chez les femmes enceintes dont le traitement initial fait appel à de l'héparine de bas poids moléculaire à dose thérapeutique, la numération plaquettaire devrait être déterminée au départ, puis l'être à nouveau une semaine plus tard, aux fins du dépistage de la thrombocytopénie induite par l'héparine. (III-C) 12. Chez les femmes enceintes qui présentent une thromboembolie veineuse aiguë, nous recommandons la mise en Åuvre d'une anticoagulation thérapeutique pendant au moins trois mois. (I-A) 13. À la suite du traitement initial, l'intensité de l'anticoagulation peut être atténuée en passant à une dose intermédiaire ou prophylactique pour le reste de la grossesse et pour une période d'au moins six semaines à la suite de l'accouchement. (III-C) 14. Chez les femmes enceintes qui présentent une thrombose veineuse profonde aiguë proximale de la jambe, l'utilisation de bas de contention gradués peut être envisagée pour le soulagement des symptômes. (III-C) 15. Le recours à la thrombolyse pendant la grossesse ne devrait être envisagé qu'en présence d'une embolie pulmonaire massive ou d'une thrombose veineuse profonde menaçant l'intégrité d'un membre. (III-C) 16. Les filtres de veine cave ne devraient être utilisés que chez les femmes enceintes qui présentent une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire aiguë et des contre-indications à l'anticoagulation. (III-C) 17. Une veinographie par tomodensitométrie et/ou une imagerie par résonance magnétique devraient être menées pour écarter la présence possible (lorsque celle-ci est soupçonnée) d'une thrombose veineuse cérébrale. (I-C) 18. Une anticoagulation faisant appel à une dose thérapeutique devrait être mise en Åuvre lorsque la présence d'une thrombose veineuse cérébrale est confirmée. (II-2A) 19. À la suite d'une thrombose veineuse cérébrale, la mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie devrait être envisagée dans le cadre des grossesses subséquentes. (II-1C) 20. Dans les cas de thrombophlébite superficielle, une échographie de compression devrait être menée pour écarter la présence possible d'une thrombose veineuse profonde; (II-2A) de plus, une échographie de compression devrait être menée à nouveau lorsqu'une aggravation de la phlébite mène les fournisseurs de soins à soupçonner la présence d'une propagation proximale. (III-C) 21. L'administration d'héparine de bas poids moléculaire (selon des doses prophylactiques ou intermédiaires) pendant de 1 à 6 semaines est recommandée chez les femmes qui présentent une thrombophlébite superficielle bilatérale, chez les femmes très symptomatiques et chez les femmes qui présentent une thrombophlébite superficielle située à ≤ 5 cm du système veineux profond (jonctions saphénofémorale et saphénopoplitée) ou affectant ≥ 5 cm d'une veine. (I-A) 22. La seule mise en Åuvre d'une observation est recommandée chez les femmes présentant une thrombophlébite superficielle qui sont exposées à de faibles risques de thrombose veineuse profonde et chez les femmes qui ne nécessitent pas la mise en Åuvre d'une maîtrise des symptômes. Ces femmes devraient faire l'objet d'un suivi clinique mené dans les sept à dix jours; de plus, une nouvelle échographie de compression devrait être menée chez ces femmes dans un délai d'une semaine. (I-A) 23. La tomodensitométrie et/ou l'imagerie par résonance magnétique (avec ou sans angiographie) sont les modalités d'imagerie de référence pour ce qui est d'écarter la présence possible d'une thrombose de la veine ovarienne. (II-2A) 24. Lorsque la présence d'une thrombose de la veine ovarienne est confirmée, nous recommandons l'administration d'antibiotiques à large spectre par voie parentérale; nous recommandons également que ce traitement se poursuive pendant au moins 48 heures à la suite de la défervescence et de l'amélioration clinique. (II-2A) Une antibiothérapie de plus longue durée s'avère nécessaire en présence d'une septicémie ou d'infections compliquées. (III-C) 25. Lorsque la présence d'une thrombose de la veine ovarienne est confirmée, la mise en Åuvre d'une anticoagulation (selon des doses thérapeutiques) pourrait être envisagée pendant de 1 à 3 mois. (III-C) 26. Le dépistage systématique de toutes les thrombophilies héréditaires chez toutes les femmes connaissant un premier épisode de thromboembolie veineuse diagnostiqué pendant la grossesse ne s'avère pas indiqué. (III-C) 27. Le dépistage des déficits en protéine S, en protéine C et en antithrombine s'avère indiqué à la suite d'un épisode de thromboembolie veineuse pendant la grossesse, en présence d'antécédents familiaux où figurent ces thrombophilies particulières ou lorsqu'une thrombose se manifeste à un endroit inhabituel. (III-C) 28. Le dépistage des anticorps antiphospholipides s'avère indiqué lorsque les résultats d'un tel dépistage affecteraient la durée de l'anticoagulation. (III-C) 29. Une évaluation du risque personnel de connaître une thromboembolie veineuse devrait être menée avant toutes les grossesses et une fois la présence d'une grossesse confirmée; une telle évaluation devrait également être menée à nouveau tout au long de la grossesse, au fur et à mesure que se manifestent de nouvelles situations cliniques. Les préférences et les valeurs de la patiente devraient être prises en considération lorsque l'on envisage d'avoir recours à la thromboprophylaxie antepartum. (III-B) 30. Les femmes qui sont exposées à un risque accru devraient être avisées des symptômes de la thromboembolie veineuse. (III-B) 31. L'héparine de bas poids moléculaire est l'agentpharmacologique à privilégier, par rapport à l'héparine non fractionnée, aux fins de la thromboprophylaxie antepartum. (III-A) Les doses d'héparine de bas poids moléculaire devraient être utilisées conformément aux recommandations des fabricants. (III-C) 32. L'administration systématique d'un agent anti-Xa et la surveillance du taux de plaquettes ne sont pas recommandées lorsque la patiente fait l'objet d'une thromboprophylaxie selon une dose prophylactique. (II-2E) 33. Nous recommandons la mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie thérapeutique au cours de la grossesse dans les situations suivantes : a. une anticoagulation thérapeutique à long terme a été utilisée avant la grossesse en raison d'une indication persistante; (III-B) b. des antécédents personnels de multiples thromboembolies veineuses. (III-B) 34. Nous recommandons la mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie intermédiaire ou thérapeutique au cours de la grossesse dans la situation suivante : a. des antécédents personnels de thromboembolie veineuse et de thrombophilie à risque élevé (déficit en antithrombine, syndrome des antiphospholipides) n'ayant pas auparavant fait l'objet d'un traitement d'anticoagulation. (III-B) 35. Nous recommandons la mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie selon une dose prophylactique au cours de la grossesse dans les situations suivantes (risque absolu > 1 %) : a. des antécédents personnels de thromboembolie veineuse non provoquée; (II-2A) b. des antécédents personnels de thromboembolie veineuse associée aux contraceptifs oraux ou à la grossesse; (II-2A) c. des antécédents personnels de thromboembolie veineuse provoquée et de quelque thrombophilie à faible risque que ce soit; (I-A) d. la présence d'un facteur V de Leiden homozygote asymptomatique; (II-2A) e. la présence d'une mutation du gène 20210A de la prothrombine homozygote asymptomatique; (III-B) f. la présence d'une thrombophilie combinée asymptomatique; (III-B) g. la présence d'un déficit en antithrombine asymptomatique; (III-B) h. la tenue d'une chirurgie non obstétricale pendant la grossesse, s'accompagnant d'une thromboprophylaxie dont la durée dépend de l'intervention et de la patiente; (III-B) i. un alitement strict antepartum pendant ≥ 7 jours chez une femme dont l'indice de masse corporelle était > 25 kg/m2 au moment de sa première consultation prénatale. (II-2B) 36. La mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie antepartum en raison de la présence isolée d'un des facteurs de risque associés à la grossesse n'est pas recommandée. (III-E) 37. La mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie antepartum devrait être envisagée en présence de multiples facteurs de risque cliniques ou associés à la grossesse lorsque l'on estime que le risque absolu global de TEV est supérieur à 1 %, particulièrement chez les patientes qui sont hospitalisées en vue d'un alitement. (II-2B) 38. La mise en Åuvre systématique d'une thromboprophylaxie ne s'avère pas nécessaire chez toutes les femmes qui subissent un déclenchement de l'ovulation. (III-C) 39. Lorsque le recours aux techniques de procréation assistée donne lieu à un syndrome d'hyperstimulation ovarienne grave, nous recommandons la mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie à l'héparine de bas poids moléculaire pour une durée d'au moins 8 à 12 semaines à la suite de la résolution de ce syndrome. (III-B) 40. La mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie à l'héparine de bas poids moléculaire devrait être envisagée, au moment de la stimulation ovarienne, chez toutes les femmes exposées à un risque accru de thromboembolie veineuse qui ont recours à des techniques de procréation assistée. (III-B) 41. Les femmes qui en viennent à présenter une thromboembolie veineuse en association avec le recours aux techniques de procréation assistée, mais qui n'obtiennent pas une grossesse dans le cadre du cycle en question, devraient être traitées au moyen d'une anticoagulation thérapeutique pendant au moins trois mois. (II-3A) Les femmes qui obtiennent une grossesse dans le cadre du cycle de procréation assistée en question devraient être traitées conformément aux recommandations 12 et 13 traitant de la présence d'une thromboembolie veineuse aiguë pendant la grossesse. (I-A, III-C) 42. Les femmes faisant l'objet d'une anticoagulation thérapeutique ou administrée selon une dose prophylactique ou intermédiaire devraient être avisées de leurs options en matière d'analgésie / anesthésie avant l'accouchement. (III-B) 43. À terme (37 semaines), le passage de l'héparine de bas poids moléculaire thromboprophylactique à l'héparine non fractionnée administrée selon une dose prophylactique pourrait être envisagé de façon à permettre l'offre d'un plus grand nombre d'options en matière d'analgésie pendant le travail. (III-L) 44. Le traitement à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire administrée selon une dose prophylactique ou intermédiaire doit être suspendu à l'apparition spontanée du travail ou au cours de la journée précédant la tenue planifiée d'un déclenchement du travail ou d'une césarienne. (II-3B) 45. Une numération plaquettaire récente devrait être disponible au moment de l'admission en salle de travail ou avant la tenue d'une césarienne pour les femmes qui ont reçu ou qui reçoivent des anticoagulants. (III-B) 46. Chez les femmes qui reçoivent de l'héparine de bas poids moléculaire, une anesthésie centrale peut être administrée comme suit : a. dose prophylactique : de 10 à 12 heures après la dernière dose, au minimum; (III-B) b. dose thérapeutique : 24 heures à la suite de la dernière dose. (III-B) 47. Chez les femmes qui reçoivent de l'héparine non fractionnée, une anesthésie centrale peut être administrée comme suit : a. dose prophylactique (maximum 10 000 U/jour) : sans délai; (III-B) b. perfusion thérapeutique : au moins 4 heures après l'arrêt de la perfusion et lorsque le temps de céphaline activée est normal; (III-B) c. héparine non fractionnée sous-cutanée à dose thérapeutique : lorsque le temps de céphaline activée est normal (cela pourrait prendre 12 heures ou plus à la suite de la dernière injection). (III-B) 48. La mise en Åuvre d'une anesthésie centrale doit être évitée chez les femmes ayant fait l'objet d'une anticoagulation exhaustive ou en présence de symptômes indiquant une altération de la coagulation. (II-3A) 49. Le retrait d'un cathéter péridural / rachidien laissé in situ postpartum ne devrait être effectué que 4 heures, de 10 à 12 heures ou 24 heures à la suite de l'administration d'héparine non fractionnée à dose prophylactique (maximum 10 000 U/jour), d'héparine de bas poids moléculaire à dose prophylactique (une seule dose quotidienne) ou d'héparine de bas poids moléculaire à dose thérapeutique, respectivement, ou, dans le cas de l'administration d'héparine non fractionnée à dose thérapeutique, que lorsque le temps de céphaline activée est normal. (II-3B) 50. L'administration d'héparine de bas poids moléculaire à dose prophylactique (une seule dose quotidienne) peut être démarrée ou redémarrée quatre heures après le retrait d'un cathéter péridural / rachidien, pour autant que l'on constate une récupération neurologique totale et l'absence de symptômes indiquant des saignements évolutifs ou une coagulopathie. (III-B) 51. L'administration d'héparine de bas poids moléculaire à dose thérapeutique peut être démarrée ou redémarrée au moins 24 heures après un bloc central en injection unique et au moins 4 heures après le retrait d'un cathéter péridural / rachidien, pour autant que l'on constate une récupération neurologique totale et l'absence de symptômes indiquant des saignements évolutifs ou une coagulopathie. (III-B) 52. L'administration d'héparine non fractionnée par voie sous-cutanée peut être démarrée ou redémarrée au moins 1 heure après un bloc central en injection unique, pour autant que l'on constate une récupération neurologique totale et l'absence de symptômes indiquant des saignements évolutifs ou une coagulopathie. (III-B) 53. N'administrez pas des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire (acide acétylsalicylique ou anti-inflammatoires non stéroïdiens) et de l'héparine de façon concomitante lorsqu'un cathéter péridural / rachidien est laissé in situ postpartum. (III-D) 54. Les femmes qui reçoivent une anticoagulation thérapeutique et qui ont subi une anesthésie centrale devraient faire l'objet d'une surveillance étroite visant l'apparition possible d'un hématome spinal. (III-B) 55. La mise en Åuvre universelle d'une thromboprophylaxie postpartum n'est pas recommandée. (III-D) 56. Cherchez à déterminer la présence d'un risque accru de thromboembolie veineuse postpartum après chaque accouchement, en fonction des facteurs de risque antepartum, intrapartum et postpartum, et répétez le processus au fur et à mesure que se manifestent de nouvelles situations cliniques. (II-2B) 57. L'héparine de bas poids moléculaire est l'agent pharmacologique à privilégier, par rapport à l'héparine non fractionnée, aux fins de la thromboprophylaxie postpartum. (III-A) Les doses d'héparine de bas poids moléculaire devraient être utilisées conformément aux recommandations des fabricants. (III-C) 58. La mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie postpartum pharmacologique est recommandée dans les situations suivantes : Présence d'un des facteurs de risque suivants (chacun de ces facteurs de risque donnant lieu à un risque absolu de thromboembolie veineuse > 1 %) : a. quelque antécédent de thromboembolie veineuse que ce soit; (II-2A) b. quelque thrombophilie à risque élevé que ce soit : syndrome des antiphospholipides, déficit en antithrombine, présence d'une mutation du gène 20210A de la prothrombine ou d'un facteur V de Leiden homozygote, thrombophilie combinée; (II-2B) c. alitement strict avant l'accouchement pendant 7 jours ou plus; (II-2B) d. perte sanguine peripartum ou postpartum > 1 litre ou remplacement des produits sanguins et tenue concomitante d'une chirurgie postpartum; (II-2B) e. infection peripartum / postpartum. (II-2B) 59. La mise en Åuvre d'une thromboprophylaxie postpartum devrait être envisagée en présence de multiples facteurs de risque cliniques ou associés à la grossesse, lorsque l'on estime que le risque absolu global est supérieur à 1 % : a. présence de deux des facteurs de risque suivants (chacun de ces facteurs de risque donnant lieu à un risque absolu de thromboembolie veineuse < 1 %) : i. indice de masse corporelle ≥ 30 kg/m2 au moment de la première consultation antepartum; (II-2B) ii. fait de fumer > 10 cigarettes/jour pendant la période antepartum; (II-2B) iii. prééclampsie; (II-2B) iv. retard de croissance intra-utérin; (II-2B) v. placenta prævia; (II-2B) vi. césarienne d'urgence; (II2B) vii. perte sanguine peripartum ou postpartum > 1 litre ou remplacement des produits sanguins; (II-2B) viii. quelque thrombophilie à faible risque que ce soit : déficit en PC ou en PS, présence d'une mutation du gène 20210A de la prothrombine ou d'un facteur V de Leiden hétérozygote; (III-B) ix. cardiopathie maternelle, lupus érythémateux disséminé, drépanocytose, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, varices, diabète gestationnel; (III-B) x. accouchement préterme; (III-B) xi. mortinaissance. (III-B) b. présence d'au moins trois des facteurs de risque suivants (chacun de ces facteurs de risque donnant lieu à un risque absolu de thromboembolie veineuse < 1 %) : i. âge > 35 ans; (II-2B) ii. parité ≥ 2; (II-2B) iii. utilisation de quelque technique de procréation assistée que ce soit; (II-2B) iv. grossesse multiple; (II-2B) v. décollement placentaire; (II-2B) vi. rupture prématurée des membranes; (II-2B) vii. césarienne planifiée; (II-2B) viii. cancer maternel. (III-B) 60. L'utilisation d'appareils de compression pneumatique intermittente ou séquentielle constitue une solution de rechange lorsque l'héparine est contre-indiquée pendant la période postpartum. Lorsque le risque de thromboembolie veineuse postpartum est élevé, ces appareils peuvent être utilisés conjointement avec de l'héparine de bas poids moléculaire ou de l'héparine non fractionnée. (III-B) 61. Les femmes qui présentent des facteurs de risque évolutifs et persistants devraient faire l'objet d'une thromboprophylaxie postpartum pendant au moins six semaines à la suite de l'accouchement. (II-3B) 62. Les femmes qui présentent des facteurs de risque antepartum ou intrapartum transitoires devraient faire l'objet d'une thromboprophylaxie postpartum jusqu'à l'obtention de leur congé de l'hôpital ou pendant jusqu'à deux semaines à la suite de l'accouchement. (III-C) 63. Le dépistage universel des thrombophilies n'est pas indiqué chez les femmes qui connaissent des issues de grossesse indésirables (prééclampsie grave, retard de croissance intra-utérin, mortinaissance). (II-2D) 64. Les femmes qui connaissent des pertes fÅtales tardives ou des fausses couches récurrentes devraient faire l'objet d'un dépistage visant le syndrome des antiphospholipides. (I-B) 65. L'utilisation d'acide acétylsalicylique à faible dose (avec ou sans héparine de bas poids moléculaire) est recommandée pendant la grossesse pour les femmes chez qui la présence du syndrome des antiphospholipides est confirmée. (I-C) 66. Lorsque la présence du syndrome des antiphospholipides n'a pas été confirmée, l'utilisation concomitante d'acide acétylsalicylique à faible dose et d'héparine de bas poids moléculaire n'est pas recommandée chez les femmes qui présentent des antécédents de fausses couches récurrentes. (I-E) 67. L'héparine de bas poids moléculaire ne devrait pas être utilisée de façon systématique aux fins de l'atténuation du risque de complications à médiation placentaire récurrentes chez les femmes qui présentent ou non une thrombophilie (en l'absence du syndrome des antiphospholipides). (I-C).
Assuntos
Fibrinolíticos/uso terapêutico , Complicações Hematológicas na Gravidez/diagnóstico , Complicações Hematológicas na Gravidez/terapia , Tromboembolia Venosa/diagnóstico , Tromboembolia Venosa/terapia , Doença Aguda , Algoritmos , Feminino , Humanos , GravidezRESUMO
OBJECTIVE: To determine whether the congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) volume ratio (CVR) is associated with fetal and postnatal outcome after prenatal diagnosis and antenatal expectant management in a provincial tertiary referral center that does not offer fetal surgery. METHODS: Retrospective cohort of 71 consecutive cases of prenatally diagnosed CCAM meeting study criteria (1996-2004). CVR was calculated on the initial ultrasound at the referral center, and associated with hydrops (Fisher's exact test) and a composite adverse postnatal outcome consisting of death, intubation for respiratory distress, extracorporeal membrane oxygenation, non-elective surgery for symptomatology, or respiratory infection requiring hospital admission (Mann-Whitney test). RESULTS: A CVR > 1.6 was significantly associated with hydrops (p = 0.003). In addition, the CVR was significantly associated with the composite adverse postnatal outcome (p = 0.004) at a mean age of follow-up of 41 months (range < 1-117 months). For CVR and postnatal outcome, the area-under-the-curve receiver operating characteristic was 0.81 (95% CI 0.69-0.93, p = 0.006), and choosing a CVR cut-off of < 0.56, the negative predictive value was 100% (95% CI 0.85-1.00). CONCLUSION: In a provincial referral center with antenatal expectant management of CCAM, the CVR was associated with hydrops and postnatal outcome, with a CVR < 0.56 predictive of good prognosis after birth.
Assuntos
Malformação Adenomatoide Cística Congênita do Pulmão/diagnóstico por imagem , Malformação Adenomatoide Cística Congênita do Pulmão/cirurgia , Ultrassonografia Pré-Natal , Adulto , Criança , Pré-Escolar , Estudos de Coortes , Feminino , Humanos , Hidropisia Fetal/diagnóstico por imagem , Hidropisia Fetal/cirurgia , Lactente , Recém-Nascido , Masculino , Valor Preditivo dos Testes , Gravidez , Prognóstico , Estudos Retrospectivos , Resultado do Tratamento , Ultrassonografia Pré-Natal/estatística & dados numéricosRESUMO
AIMS: To compare the disposition of fluoxetine and norfluoxetine enantiomers in the mother, foetus and infant. METHODS: Blood from pregnant women taking fluoxetine (n = 9), during pregnancy was sampled in the third trimester and at delivery (maternal and cord venous blood), and from the infants 48 h after delivery. The subset of these women who were breastfeeding, plus additional subjects recruited in the postpartum period, were studied further, and maternal and infant blood, and breast milk was sampled between 6 days and 11 months (n = 23). Drug and metabolite concentrations were measured using gas chromatography/mass spectrometry or liquid chromatography, tandem mass spectrometry. RESULTS: There was a high correlation between maternal and foetal (cord blood) fluoxetine and norfluoxetine enantiomers (r(2)-0.9), the mean foetal/maternal ratios (95% confidence intervals) being 0.91 (0.61, 1.02) and 1.04 (0.93, 1.05), for fluoxetine and norfluoxetine, respectively. In 2 day old infants exposed to the drug in utero, the fluoxetine and norfluoxetine plasma concentrations were the same as in cord blood at delivery. Over the next 2 months, the plasma concentrations in the infants fell progressively. Stereoselective disposition of both the drug and metabolite in the mother, foetus, infant and breast milk was observed. The S : R ratios in the foetus and newborn ( approximately 3) were significantly higher than in the serum ( approximately 2) or breast milk ( approximately 1.9) of the mothers, resulting in greater exposure of the foetus and infants to the biologically active enantiomers, particularly S-norfluoxetine. CONCLUSIONS: Foetal and infant exposure to fluoxetine and norfluoxetine is enhanced by their stereoselective disposition in the mother, foetus, breast milk and infant. Increased exposure may also result from decreased metabolism of the drug in the foetus and neonate.
Assuntos
Antidepressivos de Segunda Geração/sangue , Aleitamento Materno , Transtorno Depressivo Maior/sangue , Fluoxetina/sangue , Troca Materno-Fetal , Complicações na Gravidez/sangue , Adulto , Envelhecimento/sangue , Antidepressivos de Segunda Geração/uso terapêutico , Transtorno Depressivo Maior/tratamento farmacológico , Feminino , Sangue Fetal/metabolismo , Fluoxetina/análogos & derivados , Fluoxetina/uso terapêutico , Humanos , Recém-Nascido , Leite Humano/química , Período Pós-Parto/sangue , Gravidez , Complicações na Gravidez/tratamento farmacológico , Estudos Prospectivos , EstereoisomerismoRESUMO
OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate the ability of two different modes of antepartum fetal testing to screen for the presence of peripartum morbidity, as measured by the cesarean delivery rate for fetal distress in labor. STUDY DESIGN: Over a 36-month period, all patients who were referred to the Fetal Assessment Unit at BC Women's Hospital because of a perceived increased fetal antepartum risk at a gestational age of > or =32 weeks of gestation were approached to participate in this study. Fetal surveillance of these women was allocated randomly to either umbilical artery Doppler ultrasound testing or nonstress testing as a screening test for fetal well-being. If either the umbilical artery Doppler testing or the nonstress testing was normal, patients were screened subsequently with the same technique, according to study protocol. When the Doppler study showed a systolic/diastolic ratio of >90th percentile or the nonstress testing was equivocal (ie, variable decelerations), an amniotic fluid index was performed, as an additional screening test. When the amniotic fluid index was abnormal (<5th percentile), induction and delivery were recommended. When the Doppler study showed absent or reversed diastolic blood flow or when the nonstress test result was abnormal, induction and delivery were recommended to the attending physician. Statistical comparisons between groups were performed with an unpaired t test for normally distributed continuous variables and chi(2) test for categoric variables. RESULTS: One thousand three hundred sixty patients were assigned randomly to groups in the study; 16 patients were lost to follow up. Six hundred forty-nine patients received Doppler testing and 691 received nonstress testing. The mean number of visits for the Doppler test and nonstress test groups was two versus two, respectively. The major indications for fetal assessment included postdates (43%), decreased fetal movement (22%), diabetes mellitus (11%), hypertension (10%), and intrauterine growth restriction (7%). The incidence of cesarean delivery for fetal distress was significantly lower in the Doppler group compared with the nonstress testing group (30 [4.6%] vs 60 [8.7%], respectively; P <.006). The greatest impact on the reduction in cesarean deliveries for fetal distress was seen in the subgroups in which the indication for testing was hypertension and suspected intrauterine growth restriction. CONCLUSION: Umbilical artery Doppler as a screening test for fetal well-being in a high-risk population was associated with a decreased incidence of cesarean delivery for fetal distress compared to the nonstress testing, with no increase in neonatal morbidity.
Assuntos
Monitorização Fetal , Feto/fisiologia , Complicações na Gravidez , Ultrassonografia Pré-Natal , Artérias Umbilicais/diagnóstico por imagem , Adulto , Cesárea/estatística & dados numéricos , Feminino , Sofrimento Fetal/cirurgia , Monitorização Fetal/métodos , Humanos , Gravidez , Fatores de RiscoAssuntos
Síndrome Antifosfolipídica/tratamento farmacológico , Complicações na Gravidez/tratamento farmacológico , Aspirina/administração & dosagem , Aspirina/uso terapêutico , Feminino , Heparina/administração & dosagem , Heparina/uso terapêutico , Humanos , Gravidez , Ensaios Clínicos Controlados Aleatórios como AssuntoRESUMO
OBJECTIVE: Our purpose was to compare the efficacy of oral misoprostol with that of vaginal misoprostol for midtrimester termination of pregnancy. STUDY DESIGN: Women seen for midtrimester pregnancy termination were randomly assigned to receive either misoprostol orally in a dose of 200 microg every hour for 3 hours followed by 400 microg every 4 hours or vaginally in a dose of 400 microg every 4 hours. The protocol was followed for 24 hours, after which time further management was at the discretion of the attending physician. The primary outcome measure was the induction-to-delivery interval. Sample size was calculated a priori. Statistical analysis was performed with the t test for continuous variables and the chi(2) test for categorical variables. P <.05 was considered significant. RESULTS: One hundred fourteen women were randomized, with 49 receiving vaginal misoprostol and 65 receiving oral misoprostol. The two groups were comparable with respect to maternal age, parity, indication for pregnancy termination, gestational age, and maternal weight. The mean induction-to-delivery interval was significantly shorter for the vaginal group (19.6 +/- 17.5 hours vs 34.5 +/- 28.2 hours, P <.01). Length of stay was also shorter in the vaginal group (32.3 +/- 17.3 hours vs 50.9 +/- 27.9 hours, P <.01). Significantly more patients in the vaginal group were delivered within 24 hours (85.1% vs 39.5%, P <.01), and more patients in the oral group required changes in the method of induction when they were undelivered after 24 hours (38.2% vs 7%, P <.01). The only complication was an increase in febrile morbidity in the vaginal group (25% vs 6.7%, P =.046). This did not result in an increased use of antibiotics, and all the fevers resolved post partum without further complications. CONCLUSIONS: Vaginal administration of misoprostol resulted in a shorter induction-to-delivery interval. The shorter length of stay should result in improved patient care.
Assuntos
Abortivos não Esteroides/administração & dosagem , Aborto Induzido , Misoprostol/administração & dosagem , Abortivos não Esteroides/efeitos adversos , Abortivos não Esteroides/uso terapêutico , Administração Intravaginal , Administração Oral , Adulto , Parto Obstétrico , Feminino , Febre/induzido quimicamente , Humanos , Tempo de Internação , Misoprostol/efeitos adversos , Misoprostol/uso terapêutico , Gravidez , Segundo Trimestre da Gravidez , Transtornos Puerperais/induzido quimicamente , Retratamento , Fatores de TempoRESUMO
OBJECTIVE: to identify risk factors for venous thromboembolism (VTE) in the peripartum period and to provide guidelines for risk assessment and thromboprophylactic measures for VTE in pregnant women. Guidelines for diagnostic testing and for acute and long term treatment of VTE are also provided.OPTIONS: specific subgroups of pregnant women are defined and appropriate prophylactic measures are outlined. OUTCOMES: venous thromboembolism remains a major cause of morbidity and mortality in pregnancy and the postpartum period. Identification of risk and adequate prophylaxis can decrease the incidence of VTE.EVIDENCE: evidence was gathered using Medline (National Library of Medicine) to identify relevant studies and from bibliographies of articles thus identified.RECOMMENDATIONS: although evidence is lacking to date from Grade I studies (properly controlled randomized studies) in pregnant patients, there is good evidence to support the role of prophylaxis in reducing the incidence of VTE in patients identified to be at risk in the non-pregnant population (II B). Based on risk assessment more patients should be considered for thromboprophylaxis, including women with a past history of a VTE and a known thrombophilia on long-term anticoagulation, women with a past history of a VTE, women with a known thrombophilia who have never experienced a VTE and potentially considered in women at the time of Caesarean section (II B; III C). The occurrence of VTE is effectively reduced by the use of low dose unfractionated heparin. Experience with low molecular weight heparin and pregnancy is building, but is limited at present. Unfractionated heparin remains the standard for the treatment of VTE in pregnancy at the present time. Following initial heparinization for the treatment of VTE, patients should be continued on anticoagulation throughout pregnancy and for six to 12 weeks postpartum or a total of three months of anticoagulation (II A).