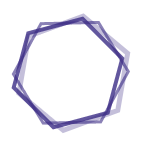RESUMO
Background: Support for the role of an emergency department (ED) clinical pharmacy team is evidence-based and recognized in numerous professional guidelines, yet previous literature suggests a low prevalence of ED clinical pharmacy services in Canadian hospitals. Objectives: To update (from a survey conducted in 2013) the description and quantification of clinical pharmacy services in Canadian EDs. Methods: All Canadian hospitals with an ED and at least 50 acute care beds were contacted to identify the presence of dedicated ED pharmacy services (defined as at least 0.5 full-time equivalent [FTE] position). Three separate electronic surveys were distributed by email to ED pharmacy team members (if available), pharmacy managers (at hospitals without an ED pharmacy team), and ED managers (all hospitals). The surveys were completed between November 2021 and January 2022. Results: Of the 254 hospitals identified, 117 (46%) had at least 0.5 FTE clinical pharmacy services in the ED (based on initial telephone screening). Of the 51 (44%) of 115 ED pharmacy team survey responses included in the analysis, 94% (48/51) had pharmacists and 55% (28/51) had pharmacy technicians. The majority of pharmacy managers and ED managers identified the need for ED pharmacy services where such services did not exist. Inadequate funding, competing priorities, and lack of training remain the most commonly reported barriers to providing this service. Personal safety concerns were reported by 20% (10/51) of respondents. Conclusions: Although the establishment of clinical pharmacy services in Canadian EDs has grown over the past 8 years, lack of funding and ED-specific training continue to limit this evidence-supported role in Canadian hospitals.
Contexte: La pratique de pharmacie clinique au service des urgences (SU) est fondée sur les données probantes et reconnue dans de nombreuses lignes directrices professionnelles. Cependant, des données portent à croire à une faible prévalence de ces services dans les SU des hôpitaux canadiens. Objectif: Mettre à jour la description et la quantification des services de pharmacie clinique dans les SU canadiens (à partir d'une enquête menée en 2013). Méthodes: Tous les hôpitaux canadiens dotés d'un SU et d'au moins 50 lits de soins de courte durée ont été contactés pour recenser la présence de services de pharmacie dédiés au SU (définis comme au moins 0,5 poste équivalent temps complet [ETC]). Trois sondages électroniques différents ont été distribués par courriel aux membres de l'équipe de la pharmacie du SU (le cas échéant), aux gestionnaires de pharmacie (dans les hôpitaux sans équipe de pharmacie au SU) et aux gestionnaires du SU (tous les hôpitaux). Les enquêtes ont été réalisées entre novembre 2021 et janvier 2022. Résultats: Sur les 254 hôpitaux recensés, 117 (46 %) disposaient d'au moins 0,5 ETC de services de pharmacie clinique au SU (d'après la sélection téléphonique initiale). Des 51 (44 %) sur 115 équipes de pharmacie du SU qui ont été inclus dans l'analyse, 94 % (48/51) avaient des pharmaciens et 55 % (28/51) avaient également du personnel technique en pharmacie. La majorité des directeurs de pharmacie et des directeurs des SU ont identifié le besoin de services de pharmacie au SU là où de tels services n'existent pas. Un financement inadéquat, des priorités concurrentes et le manque de formation demeurent les obstacles les plus souvent signalés à la prestation de ce service. Des problèmes de sécurité personnelle ont été mentionnés par 20 % (10/51) des répondants. Conclusion: Bien que l'établissement de services de pharmacie clinique dans les SU canadiens ait augmenté au cours des 8 dernières années, le manque de financement et de formation spécifique en pharmacie de médecine d'urgence continue de limiter ce rôle fondé sur des données probantes dans les hôpitaux canadiens.
RESUMO
BACKGROUND: The rate of potential adverse drug events is reported to be 3 times higher among pediatric inpatients than among their adult counterparts. Various methods have been suggested to reduce medication errors in pediatric patients. One of the most influential of these strategies is inclusion of a clinical pharmacist on the multidisciplinary care team. However, there is currently no literature describing the inventory of pharmacy services provided to pediatric patients in Canadian adult hospitals. OBJECTIVES: The primary objective of this study was to describe pediatric and neonatal pharmacy services provided in adult hospitals in Canada. The secondary objective was to determine whether the services provided correspond to services that pharmacists working in Canadian pediatric hospitals identified as important for adult hospitals that provide pediatric services. METHODS: Two web-based surveys were created, focusing on 35 pharmacy services. The first survey was intended for adult hospitals, and the second for pediatric hospitals. The surveys were distributed by e-mail and were completed in January and February 2018. RESULTS: A total of 55 and 43 valid responses were received from respondents in adult hospitals and pediatric hospitals, respectively. An inventory of pharmacy services provided by adult hospitals to their pediatric and neonatal patients was obtained. Of the adult hospitals that responded, 61% (33/54) had pharmacists assigned to pediatric or neonatal units. The frequency with which most pharmacy services were provided was comparable to the importance identified by pharmacists working in pediatric hospitals. However, for the provision of education during admission and at discharge and for the provision of medication reconciliation at discharge, frequency and importance were not comparable. CONCLUSIONS: Adult hospitals with a pharmacist assigned to an inpatient pediatric or neonatal clinical area met most expectations of pharmacists working in pediatric hospitals in terms of pharmacy services provided. However, some services require optimization for this patient population.
CONTEXTE: On rapporte que le taux de réactions indésirables potentielles aux médicaments est trois fois plus élevé chez les enfants hospitalisés que chez les adultes. Diverses méthodes ont été proposées pour réduire les erreurs de médication chez les patients pédiatriques. L'une des stratégies les plus influentes consiste à inclure un pharmacien clinique au sein de l'équipe de soins pluridisciplinaire. Cependant, il n'existe actuellement aucun document dressant l'inventaire des services de pharmacie offerts aux patients pédiatriques dans les hôpitaux canadiens pour adultes. OBJECTIFS: L'objectif principal de cette étude consistait à décrire les services de pharmacie pédiatriques et néonataux offerts dans les hôpitaux pour adultes au Canada. L'objectif secondaire consistait quant à lui à déterminer si les services offerts à la population pédiatrique dans les hôpitaux pour adultes correspondaient à ceux que les pharmaciens travaillant dans les hôpitaux pédiatriques canadiens reconnaissaient comme étant importants. MÉTHODES: Deux sondages en ligne se focalisant sur 35 services de pharmacie ont été créés. Le premier était destiné aux hôpitaux pour adultes et le deuxième aux hôpitaux pédiatriques. Les sondages ont été distribués par courriel et effectués en janvier et février 2018. RÉSULTATS: Cinquante-cinq (55) répondants des hôpitaux pour adultes et 43 des hôpitaux pédiatriques y ont répondu en bonne et due forme. Les investigateurs ont obtenu en outre la liste des services de pharmacie offerts par les hôpitaux pour adultes à leurs patients pédiatriques et néonataux. Soixante et un pour cent (61 %), soit 33 sur 54, des répondants provenant des hôpitaux pour adultes à étaient des pharmaciens affectés aux unités pédiatriques ou néonatales. La fréquence de l'offre de la majorité des services de pharmacie était d'importance comparable à ce que les pharmaciens travaillant dans les hôpitaux pédiatriques ont relevé. Toutefois, pour ce qui est des instructions données au patient à l'admission et au congé et de la prestation du bilan des médicaments au congé, la fréquence et l'importance de ces services n'étaient pas comparables. CONCLUSIONS: Les hôpitaux pour adultes disposant d'un pharmacien affecté à un domaine clinique pédiatrique ou néonatal répondaient à la plupart des attentes des pharmaciens travaillant dans les hôpitaux pédiatriques en termes d'offre de services de pharmacie. Cependant, certains services demandent à être optimisés pour cette population de patients.
RESUMO
BACKGROUND: In February 2015, the Supreme Court of Canada ruled that it was unconstitutional to prohibit physicians from assisting in a patient's consensual death, thereby setting the groundwork for the legalization of medical assistance in dying (MAiD). Much of the research on this topic has focused on physicians, although other health care professionals will be involved in the process, including pharmacists, pharmacy technicians, and pharmacy assistants. In many provinces, the medications required for MAiD will be dispensed from hospital pharmacies, which will result in direct involvement of hospital pharmacy staff. OBJECTIVES: The primary objective was to investigate the knowledge and attitudes of hospital pharmacy staff in Canada regarding MAiD. The secondary objective was to determine the factors that might influence those opinions. METHODS: A 34-question web-based survey was available for 6 weeks during early 2017 to hospital pharmacy staff throughout Canada. For most questions, responses were based on a 5-point Likert scale, ranging from "strongly agree" to "strongly disagree". Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. RESULTS: A total of 1040 valid survey responses were received: 607 from pharmacists, 273 from pharmacy technicians, and 160 from pharmacy assistants. Most respondents were supportive of MAiD; however, nearly all respondents (99% [601/607] of pharmacists, 73% [315/431] of technicians and assistants]) reported lacking comprehensive education on the topic. Despite high levels of overall support, pharmacists tended to be less supportive of MAiD than pharmacy technicians or assistants. Factors that influenced opinions included strong religious beliefs, region, and knowledge of provincial and federal legislation. CONCLUSIONS: The majority of respondents, particularly technicians and assistants, were supportive of MAiD, but most respondents lacked education about the topic.
CONTEXTE: En février 2015, la Cour suprême du Canada a statué qu'il était inconstitutionnel d'interdire aux médecins d'aider les patients à mourir par consentement, ce qui a jeté les bases de la légalisation de l'aide médicale à mourir (AMAM). Une grande partie de la recherche sur le sujet était axée sur les médecins, malgré le fait que d'autres professionnels de la santé seront appelés à participer au processus, notamment les pharmaciens, les techniciens en pharmacie et les aides-pharmaciens. Dans bien des provinces, les médicaments nécessaires à l'AMAM proviendront des pharmacies hospitalières, ce qui résultera en la participation directe du personnel de pharmacie hospitalière. OBJECTIFS: L'objectif principal visait à examiner les connaissances et l'attitude du personnel de pharmacie hospitalière au Canada relativement à l'AMAM. L'objectif secondaire était de découvrir les facteurs pouvant influencer les avis du personnel sur le sujet. MÉTHODES: Pendant six semaines, au début de 2017, un sondage en ligne de 34 questions était à la disposition du personnel de pharmacie hospitalière de partout au Canada. Inspirés de l'échelle de Likert à cinq points, les choix de réponse à la plupart des questions s'étendaient de « fortement d'accord ¼ à « fortement en désaccord ¼. Des statistiques descriptives et par inférence ont servi à analyser les données. RÉSULTATS: Des 1040 réponses valables, 607 provenaient de pharmaciens, 273 de techniciens en pharmacie et 160 d'aides-pharmaciens. La plupart des répondants étaient en faveur de l'AMAM. Cependant, près de l'ensemble des répondants (99 % [601/607] des pharmaciens et 73 % [315/431] des techniciens et des aides) ont signalé ne pas posséder une connaissance suffisante du sujet. Malgré le degré élevé de soutien apporté par l'ensemble des personnes interrogées, l'appui des pharmaciens à l'AMAM tendait à être plus faible que celui des techniciens en pharmacie ou des aides-pharmaciens. Parmi les facteurs propres à influencer les avis des répondants, on trouvait les croyances religieuses fortes, la provenance géographique et la connaissance des lois provinciales et fédérales. CONCLUSIONS: La majorité des répondants, particulièrement les techniciens et les aides, était en faveur de l'AMAM, mais la plupart des répondants ne possédaient pas une connaissance suffisante du sujet.
RESUMO
BACKGROUND: Accreditation standards have outlined the need for staff in emergency departments to initiate the medication reconciliation process for patients who are at risk of adverse drug events. The authors hypothesized that a guided form could be used by non-admitted patients in the emergency department to assist with completion of a best possible medication history (BPMH). OBJECTIVE: To determine the percentage of patients in the non-acute care area of the emergency department who could complete a guided BPMH form with no clinically significant discrepancies (defined as no major discrepancies and no more than 1 moderate discrepancy). METHODS: This prospective exploratory study was conducted over 4 weeks in February and March 2016. Data were collected using the self-administered BPMH form, patient interviews, and a data collection form. After completion of the guided BPMH form, patients were randomly selected for interview by a pharmacy team member to ensure their self-completed BPMH forms were complete and accurate. Eligible patients were those with non-acute needs who had undergone triage to the waiting room. Patients who were already admitted and those with immediate triage to the acute care or trauma area of the emergency department were excluded. RESULTS: Of the 160 patients who were interviewed, 146 (91.3%) completed the form with no more than 1 moderate discrepancy (but some number of minor discrepancies). There were no discrepancies in 31 (19.4%) of the BPMH forms, and 101 (63.1%) of the forms had only minor discrepancies. CONCLUSIONS: Most of the patients interviewed by the pharmacy team were able to complete the BPMH form with no clinically significant discrepancies. The self-administered BPMH form would be a useful tool to initiate medication reconciliation in the emergency department for this patient population, but used on its own, it would not be a reliable source of BPMH information, given the relatively low number of patients who completed the form with no discrepancies.
CONTEXTE: Les normes d'agrément ont souligné la nécessité pour le personnel des services des urgences d'amorcer le processus de bilan comparatif des médicaments chez les patients à risque d'événements indésirables liés aux médicaments. Les auteurs ont avancé que des patients au service des urgences ne requérant pas une hospitalisation pourraient remplir un formulaire dirigé et ainsi aider à établir leur meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP). OBJECTIF: Déterminer le pourcentage de patients dans l'aire de soins non urgents du service des urgences qui sont en mesure de remplir un formulaire dirigé de MSTP sans divergence cliniquement significative (c'est-à-dire aucune divergence majeure et pas plus d'une divergence modérée). MÉTHODES: La présente étude préliminaire prospective a été menée sur une période de quatre semaines en février et en mars 2016. Les données ont été recueillies à l'aide d'un formulaire autoadministré de MSTP, d'entrevue avec les patients et d'un formulaire de collecte de données. Une fois les formulaires dirigés de MSTP remplis, des patients ont été sélectionnés aléatoirement et interrogés par un des membres de l'équipe de pharmacie afin de s'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements fournis de soi-même. Les patients admissibles à l'étude étaient ceux ne nécessitant pas de soins urgents et ayant passé au triage dans la salle d'attente. Les patients déjà hospitalisés et ceux dirigés immédiatement après le triage dans l'aire de soins urgents ou de trauma du service des urgences ont été exclus. RÉSULTATS: Parmi les 160 patients interrogés, 146 (91,3 %) avaient rempli le formulaire avec au plus une divergence modérée (mais un certain nombre de divergences mineures). Dans 31 (19,4 %) des formulaires de MSTP, il n'y avait aucune divergence et, dans 101 (63,1 %) des formulaires, il n'y avait que des divergences mineures. CONCLUSIONS: La plupart des patients interrogés par l'équipe de pharmacie étaient en mesure de remplir le formulaire de MSTP sans qu'apparaisse de divergence cliniquement significative. Le formulaire autoadministré de MSTP serait un outil pratique pour établir un bilan comparatif des médicaments dans le service des urgences pour cette population de patients, mais employé seul, il ne représenterait pas une source fiable d'information sur le MSTP, compte tenu du nombre relativement restreint de patients ayant rempli le formulaire sans qu'apparaisse de divergence.
RESUMO
BACKGROUND: Canada's most recent Marihuana for Medical Purposes Regulations have changed the way in which patients access marijuana. Furthermore, if authorized by the person in charge of the hospital, a pharmacist practising in a hospital may now place orders with licensed producers for dried marijuana for in-hospital use by patients. As use of this product increases, hospital pharmacists may have an increased role in the care of patients who are using marijuana for medical purposes. OBJECTIVES: The primary objective of this study was to determine the opinions of hospital pharmacists in Canada regarding marijuana for medical purposes. The secondary objective was to assess the factors influencing these opinions. METHODS: An online survey was made available in early 2015 to licensed hospital pharmacists in Canada through individual provincial and territorial pharmacy regulatory bodies, pharmacist associations, hospital pharmacy directors, the Canadian Society of Hospital Pharmacists, and the Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Responses were based on a 5-point Likert style scale, ranging from "completely agree" to "completely disagree". RESULTS: A total of 769 valid survey responses were received. Among the respondents, 44.6% (333/747) agreed that marijuana is safe, whereas 55.2% (411/745) agreed that it is effective. Only 17.2% (129/748) agreed that they were knowledgeable about marijuana for medical purposes, and about 65% of respondents reported no formal training in this area. Factors that influenced respondents' opinions were age, education, area of clinical practice, province of work, and personal experience. CONCLUSION: Many Canadian hospital pharmacists agreed that marijuana for medical purposes is safe and effective, yet few considered themselves knowledgeable about this substance, with more than half reporting no formal training on the topic.
CONTEXTE: Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales récemment mis en vigueur au Canada a changé la façon dont les patients ont accès à ce produit. En outre, s'il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l'hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut maintenant commander auprès de producteurs autorisés de la marihuana séchée destinée à une personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé. Au fur et à mesure qu'augmente l'utilisation de cet agent, les pharmaciens d'hôpitaux pourraient avoir un rôle plus important à jouer dans les soins aux patients qui consomment de la marihuana à des fins médicales. OBJECTIFS: L'objectif principal de la présente étude était de sonder l'opinion des pharmaciens d'hôpitaux du Canada sur la question de la marihuana à des fins médicales. Le second objectif était d'évaluer les facteurs qui influencent leur opinion. MÉTHODES: Un sondage en ligne a été mis à la disposition des pharmaciens d'hôpitaux du Canada avec la participation des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la pharmacie, des associations de pharmaciens, des directeurs de pharmacie hospitalière, de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux et de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Inspirés de l'échelle de Likert à cinq points, les choix de réponse s'étendaient de « fortement en accord ¼ à « fortement en désaccord ¼. RÉSULTATS: Au total, 769 réponses valides au sondage ont été obtenues. Parmi les répondants, 44,6 % (333/747) ont affirmé que la marihuana est sécuritaire et 55,2 % (411/745) ont déclaré qu'elle est efficace. Seuls 17.2 % (129/748) ont affirmé être renseignés sur l'utilisation de la marihuana à des fins médicales et environ 65 % ont indiqué n'avoir aucune formation officielle sur le sujet. L'âge du pharmacien, sa formation, son domaine de pratique clinique, sa province d'exercice et son expérience personnelle étaient des facteurs influençant son opinion. CONCLUSION: Bon nombre de pharmaciens hospitaliers canadiens ont affirmé que l'utilisation de la marihuana à des fins médicales est sécuritaire et efficace. Or, peu considéraient être renseignés à propos de ce produit et plus de la moitié ont indiqué n'avoir aucune formation officielle sur le sujet.
RESUMO
BACKGROUND: Providing clinical pharmacy services in emergency departments (EDs) is important because adverse drug events commonly occur before, during, and after ED encounters. Survey studies in the United States have indicated a relatively low presence of clinical pharmacy services in the ED setting, but a descriptive survey specific to Canada has not yet been performed. OBJECTIVES: To describe the current status of pharmacy services in Canadian EDs and potential barriers to implementing pharmacy services in this setting. METHODS: All Canadian hospitals with an ED and at least 50 acute care beds were contacted to identify the presence of dedicated ED pharmacy services (defined as at least 0.5 full-time equivalent [FTE] position). Three different electronic surveys were then distributed by e-mail to ED pharmacy team members (if available), pharmacy managers (at hospitals without an ED pharmacy team), and ED managers (all hospitals). The surveys were completed between July and September 2013. RESULTS: Of the 243 hospitals identified, 95 (39%) had at least 0.5 FTE clinical pharmacy services in the ED (based on initial telephone screening). Of the 60 ED pharmacy teams that responded to the survey, 56 had pharmacists (27 of which also had ED pharmacy technicians) and 4 had pharmacy technicians (without pharmacists). Forty-four (79%) of the 56 ED pharmacist services had been established within the preceding 10 years. Order clarification, troubleshooting, medication reconciliation, and assessment of renal dosing were the services most commonly provided. The large majority of pharmacy managers and ED managers identified the need for ED pharmacy services where such services do not yet exist. Inadequate funding, competing priorities, and lack of training were the most commonly reported barriers to providing this service. CONCLUSIONS: Although the establishment of ward-based pharmacy services in Canadian EDs has increased over the past 10 years, lack of funding and a lack of ED training for pharmacists were reported as significant barriers to the expansion of this role in most hospitals.
CONTEXTE: Offrir des services de pharmacie clinique dans les services des urgences est important, car des événements indésirables liés aux médicaments se produisent fréquemment avant, pendant et après y avoir séjourné. Des études par sondage réalisées aux États-Unis font état d'une présence relativement faible des services de pharmacie clinique dans les services des urgences. Malheureusement, aucune enquête descriptive n'a été menée au Canada à ce jour. OBJECTIFS: Dresser le portrait actuel des services de pharmacie au sein des services des urgences du Canada et présenter les obstacles potentiels à l'établissement de services de pharmacie dans ce milieu. MÉTHODES: On a communiqué avec l'ensemble des hôpitaux canadiens disposant d'un service des urgences et d'au moins 50 lits de soins de courte durée afin de savoir s'ils profitaient de services de pharmacie consacrés au service des urgences (soit au moins 0,5 d'un poste équivalent temps plein). Trois différents sondages électroniques ont ensuite été envoyés par courriel : un aux membres du personnel de pharmacie affectés aux services des urgences (le cas échéant); un aux gestionnaires de pharmacie (des hôpitaux sans équipe de pharmacie au service des urgences); et un aux gestionnaires des services des urgences (de tous les hôpitaux). Les sondages ont été remplis entre juillet et septembre 2013. RÉSULTATS: Des 243 hôpitaux recensés, 95 (39 %) avaient au moins 0,5 d'un poste équivalent temps plein pour la prestation de services de pharmacie clinique au service des urgences (résultat établi au moyen d'une présélection téléphonique). Parmi les 60 équipes de pharmacie affectées au service des urgences ayant répondu au sondage, 56 disposaient de pharmaciens (et parmi celles-ci, 27 comptaient aussi sur des techniciens en pharmacie) et 4 étaient composées exclusivement de techniciens en pharmacie. Quarante-quatre (79 %) des 56 équipes comprenant des pharmaciens avaient été mises en place au cours des dix dernières années. La clarification des ordonnances, le dépannage, l'établissement de bilans comparatifs des médicaments et l'évaluation de l'ajustement posologique chez les insuffisants rénaux représentaient les services les plus souvent offerts. La vaste majorité des gestionnaires de pharmacie et des gestionnaires des services des urgences ont souligné la nécessité d'avoir des services de pharmacie au service des urgences dans les établissements où il n'y en avait pas encore. Le manque de financement, le nombre foisonnant de priorités et l'insuffisance de formation représentaient les éléments faisant le plus souvent obstacle à l'instauration de ce service selon les répondants. CONCLUSIONS: Bien que la mise en place de services de pharmacie clinique consacrés aux services des urgences ait augmenté au Canada durant les dix dernières années, le manque de financement et l'insuffisance de formation des pharmaciens pour le travail au service des urgences ont été présentés comme étant d'importants obstacles à l'accroissement de ce rôle dans la plupart des hôpitaux.
RESUMO
BACKGROUND: As of 2015, Accreditation Canada's Qmentum program expects emergency departments (EDs) to initiate medication reconciliation for 2 groups of patients: (1) those with a decision to admit and (2) those without a decision to admit who meet the criteria of a risk-based, health care organization-defined selection process. Pharmacist-led best possible medication histories (BPMHs) obtained in the ED are considered more complete and accurate than BPMHs obtained by other ED providers, with pharmacy technicians obtaining BPMHs as effectively as do pharmacists. A current assessment of the role of pharmacy in BPMH processes in Canadian EDs is lacking. OBJECTIVES: To identify and describe BPMH and medication reconciliation practices in Canadian EDs, including those performed by members of the ED pharmacy team. METHODS: All Canadian hospitals with an ED and at least 50 acute care beds were contacted to identify the presence of dedicated ED pharmacy services (defined as at least a 0.5 full-time equivalent position). Different electronic surveys were then distributed to ED pharmacy team members (where available) and ED managers (all hospitals). RESULTS: Survey responses were obtained from 60 (63%) of 95 ED pharmacy teams and 128 (53%) of 243 ED managers. Only 38 (30%) of the 128 ED managers believed that their current BPMH processes were adequate to obtain a BPMH for all admissions. Fifty-nine (98%) of the ED pharmacy personnel reported obtaining BPMHs (most commonly 6-10 per day), with priority given to admitted patients. Only 14 (23%) of the 60 ED pharmacy teams reported that their EDs had adequate staffing to comply with Accreditation Canada's requirements for obtaining BPMHs. This result is supported by the 104 (81%) out of 128 ED managers who reported that additional ED staffing would be needed to comply with the requirements. Numerous ED managers identified the need to expand ED pharmacy services and improve information technology support. CONCLUSIONS: BPMH processes in Canadian EDs were variable and inadequately supported. Survey responses suggested that additional staff and significant improvements in structured processes would be required to meet Accreditation Canada standards.
CONTEXTE: À compter de 2015, le programme Qmentum d'Agrément Canada s'attend à ce que les services des urgences réalisent un bilan comparatif des médicaments pour deux groupes de patients : (1) ceux que l'on décide d'admettre et (2) ceux non admis qui présentent un risque d'événements indésirables liés aux médicaments selon des critères élaborés par l'organisme. Les meilleurs schémas thérapeutiques possibles (MSTP) obtenus au service des urgences grâce aux pharmaciens sont considérés comme étant plus complets et précis que ceux dressés par d'autres fournisseurs du service des urgences. De plus, ceux obtenus par les techniciens en pharmacie sont d'une qualité égale à ceux dressés par les pharmaciens. Enfin, il n'y a pas d'évaluation actuelle du rôle joué par le personnel de la pharmacie au sein des processus d'obtention des MSTP dans les services des urgences du Canada. OBJECTIFS: Recenser les pratiques de réalisation des MSTP et des bilans comparatifs des médicaments au sein des services des urgences canadiens, notamment celles des membres des équipes de pharmacie affectés aux services des urgences, et les décrire. MÉTHODES: On a communiqué avec l'ensemble des hôpitaux canadiens disposant d'un service des urgences et d'au moins 50 lits de soins de courte durée afin de savoir s'ils profitaient de services de pharmacie consacrés au service des urgences (ce qui était défini comme au moins 0,5 d'un poste équivalent temps plein). Différents sondages électroniques ont ensuite été envoyés : un aux membres du personnel de pharmacie affectés aux services des urgences (le cas échéant); et un aux gestionnaires des services des urgences (de tous les hôpitaux). RÉSULTATS: Au total, 60 (63 %) des 95 équipes de pharmacie affectées aux services des urgences ont répondu au sondage, et 128 (53 %) des 243 gestionnaires des services des urgences ont fait de même. Seulement 38 (30 %) gestionnaires des services des urgences croyaient que leurs processus actuels convenaient à l'obtention des MSTP pour tous les patients admis. Cinquante-neuf (98 %) équipes de pharmacie affectées aux services des urgences ont déclaré dresser des MSTP (normalement de 6 à 10 par jour), la priorité étant accordée aux patients admis. Seules 14 (23 %) des 60 équipes de pharmacie affectées aux services des urgences jugeaient que leur service des urgences était doté d'un personnel suffisant pour satisfaire aux exigences d'Agrément Canada en ce qui a trait à l'obtention des MSTP. Ce résultat était corroboré par le fait que 104 (81 %) des 128 gestionnaires des services des urgences ont souligné le besoin de personnel supplémentaire au service des urgences afin de pouvoir respecter les exigences. Un grand nombre de gestionnaires des services des urgences ont reconnu la nécessité d'accroître la prestation des services de pharmacie aux services des urgences ainsi que le besoin d'améliorer le soutien par les technologies de l'information. CONCLUSIONS: Les processus d'obtention des MSTP dans les services des urgences canadiens variaient et n'avaient pas un soutien adéquat. Les réponses aux sondages semblent indiquer que du personnel supplémentaire de même que d'importantes améliorations des processus structurés seraient nécessaires pour respecter les normes d'Agrément Canada.